


Alcazaba

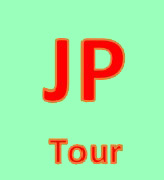
 |
 |
 |
Alcazaba |
 |
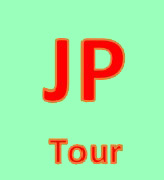 |
||
| Andalousie | Malaga | type, catégorie, genre |
|
||
L’alcazaba, qui vient de al-Qasba et qui signifie forteresse urbaine, est située sur le versant du mont Gibralfaro, dans la petite baie où se trouve la ville de Malaga. De par sa position stratégique, elle a été habitée par d’anciennes civilisations telles que les Phéniciens, qui se sont établis à cet endroit dans les années 600 av. J.-C., les Romains qui s’installèrent aux alentours de la forteresse, sur le versant sud, où ont été retrouvés des vestiges d’une ville romaine et d’installations de salage du poisson, ainsi que sur le versant ouest du mont Gibralfaro, où ils ont construit un théâtre au Ier siècle. Au cours de l’époque islamique, l’alcazaba est d’abord construite comme fortification puis devient plus tard un palais-forteresse, siège du gouvernement de la ville. C’est dans les sources remontant à l’époque de l’émirat Omeya, rattaché à la ville de Malaga, à l’époque d’Abd-al-Rahman Ier en 755, qu’apparaissent les premières mentions de l’alcazaba en tant que forteresse, et c’est au cours du VIIIe siècle également qu’est ordonnée la construction d’une mosquée aljama, ou du vendredi, à l’intérieur de l’enceinte. Il est possible qu’elle ait été située sur l’actuelle Plaza de Armas, accomplissant la fonction d’aljama jusqu’à la construction de la nouvelle grande mosquée de la ville au IXe siècle. Des restes de maisons datant de cette première période appelée Emiral ont été découverts dans la zone de l’entrée de l’alcazaba, dans un endroit qui n’a pas été occupé par la suite de par son emplacement proche de la porte de la forteresse jusqu’au XVIIIe siècle, raison pour laquelle quelques restes ont été préservés sous la maison qui a été démolie dans les années quarante. Le siècle du Califat est synonyme de prospérité. Malaga retrouve l’importance qu’elle avait durant l’antiquité en tant que ville côtière et portuaire. Actuellement, on estime que certaines parties de l’alcazaba, dont l’appareillage est en moellons en panneresse et en travers, datent de l’époque du califat, mais ces constructions ont été entièrement recouvertes par d’autres datant de la période taïfa, puis nasride. L’époque taïfa et l’année 1014 sont considérées comme le début de l’indépendance des gouverneurs locaux face au pouvoir central. Le Califat des Hammudites s’installe à Malaga, bien qu’il n’existe que très peu d’informations écrites à ce sujet. C’est une époque de grande instabilité et de pression due à l’avancée chrétienne. C’est à ce moment que sont exécutés les premiers grands travaux, raison pour laquelle on considère qu’ils sont à l’origine de la muraille. C’est la dynastie Hammudites qui modifie le caractère de simple forteresse défensive de ce bâtiment en commençant la construction du palais de l’alcazaba, qui devient le siège du pouvoir et une résidence des gouverneurs de la ville jusqu’à la conquête des chrétiens et qui est progressivement embellie et ornée des symboles liés au pouvoir. La triple arcature avec corniche arabe[1] du palais taïfa qui tente d’imiter la mode de Cordoue, et probablement la première Torre del Homenaje (donjon) située actuellement à l’intérieur du palais nasride, datent de cette époque. Quant à la forteresse, la période la plus importante pour en découvrir les secrets est celle de Badis, roi de la taïfa Ziri de Grenade qui prend la ville en 1056, expulsant ainsi les Hammudites et qui l’annexe à sa taïfa. Les Mémoires d’Abd-Allah, petit-fils de Badis, mentionnent que ce dernier fait construire un double mur doté de tous les progrès techniques et militaires de l’époque. Il fait construire une grande partie des fortifications des accès, telles que la Puerta de la Bóveda (porte de la voute) en chicane et la Puerta del Cristo (porte du Christ), de mêmes caractéristiques, qui est modifiée à l’époque nasride. Il modifie également le palais du XIe siècle des Hammudites en construisant la salle à arcs lobés, qui s’éloigne du style califal en s’adaptant à la nouvelle esthétique taïfa. La Torre del Homenaje a également été fortifiée et il devait sans doute y avoir en bas de cette tour une autre porte d’accès à la forteresse, éloignée de la ville, à en croire par le grand arc monumental construit dans le style des Madinat al-Zahra, qui devait permettre l’accès à une salle de type représentative, entrée qui a ensuite été entièrement bouchée avec du pisé à l’époque nasride. Cette tour se trouve à l’extrémité supérieure de l’enceinte supérieure et protège le palais et les zones de services. Le quartier résidentiel[2] datant de cette époque, avec les bains et le réservoir d’eau, a également été conservé. Il était destiné aux membres de la cour et aux serviteurs du palais et pouvait loger une cinquantaine de personnes. En outre, il est possible qu’il y ait eu à l’intérieur de la forteresse une rauda (cimetière) à en croire la maqabriya découverte à cet endroit. À l’époque des royaumes taïfa, les Almohades sont, selon différentes sources, à l’origine de la décoration de l’alcazaba et de la monumentalisation de la tour de Maldonado avec les colonnes en marbre et les inscriptions en caractères coufiques que l’on peut observer sur le chapiteau, ainsi que les plinthes en ocres rouges qui décorent les maisons du quartier résidentiel du XIe siècle. En outre, les mêmes sources mentionnent également que l’alcazaba a été utilisée comme prison d’État. Au cours de la dynastie Almohade, des relations importantes sont établies entre Malaga, Algésiras, Alméria et les ports du Maghreb. À cette époque, l’alcazaba est toujours une vraie ville-palais, complètement indépendante de la médina. La seconde moitié du XIVe siècle, marquée par les règnes de Yusuf I et Muhammad V (1333 à 1391) et par l’appartenance au royaume nasride de Grenade, est une époque de stabilité. La ville de Malaga se développe de manière importante et compte jusqu’à 150 000 habitants. À ce moment, la forteresse de l’alcazaba n’est plus une simple fortification et est devenue un palais-forteresse, siège du gouvernement de la ville. Il s’agit en réalité de deux forteresses l’une dans l’autre, protégées par une série de fortifications situées à l’extérieur des enceintes fermées. Vers 1340, l’artillerie est de plus en plus répandue, et il devient évident que l’intérieur de la forteresse est vulnérable à cause de sa proximité avec le mont Gibralfaro. Yusuf I entreprend donc la construction du château et de la courtine, mais il se peut que ces deux ouvrages n’aient pas été terminés à sa mort, en 1354, et qu’ils aient été achevés sous le règne de son successeur, Muhammad V. La forteresse détenait des pouvoirs politiques et administratifs, jouait le rôle de siège du gouvernement et des autorités de la ville et fonctionnait comme une petite médina indépendante, avec des fonctions administratives, résidentielles et défensives. Elle s’étend sur 14 200 m², avec 7 000 m2 construits, dont 3 478 m2 correspondent à des bâtiments civils et 3 516 m2 à des bâtiments militaires. De l’époque des Rois Catholiques à nos jours, soulignons que ces bâtiments ont été constamment réparés et ont été progressivement occupés, tout d’abord, comme zone d’artillerie, puis comme résidence du Caïd. À partir du XVIIIe siècle, avec la perte de l’influence politique de la ville et de l’administration militaire, la partie supérieure de la forteresse a été occupée par la population civile et est devenue un quartier marginal de la ville. Ce n’est qu’en 1933 que commencent les travaux de restauration qui ont permis de récupérer ce monument. |
||
Enceinte inférieure Porte de la voutesur pendentifs Il s’agit d’une tour du XIe siècle avec une porte en chicane, dénommée ainsi en raison de la magnifique voute en brique qui surmonte cette entrée. Ce système défensif est l’un des plus intéressants de la fortification et, selon l’architecte et grand spécialiste, Leopoldo Torres Balbas, la description de ce système de défense apparaitrait déjà dans les écrits des auteurs hellénistes et aurait sans doute été importé par les Byzantins. La configuration de ce passage oblige à changer de direction et empêche de voir la sortie quand on rentre. Le passage de la porte est surmonté de plusieurs arcs, le premier, rénové au XVIe siècle, en brique et en plein cintre, le suivant qui est un arc structurel permettant de former la voute est un arc outrepassé datant du XVIe siècle, comme celui situé à l’autre extrémité de la section carrée, et qui repose sur des bases en pierre réutilisées. Il y a ensuite un autre arc outrepassé visigothique avec des voussoirs en pierre et en brique du XIe siècle qui s’ouvre sur un espace vouté au niveau de la sortie de la tour et dont l’extrémité repose sur de grandes colonnes romaines réutilisées. Cette succession de toitures est intéressante à observer. Toute la partie basse de la tour est en matériau massif et dispose d’un accès original en forme de petite porte située sur le chemin de ronde et donnant sur l’intérieur de la tour. Dans le passage en chicane, on peut observer à certains endroits que la roche a été taillée et à d’autres que les vides ont été remplis avec du pisé ou de la maçonnerie pour régulariser l’intérieur. Signalons également les futs des colonnes de bâtiments romains réutilisées qui ont servi de matériau de construction. La partie supérieure de la tour et la chambre proviennent de la restauration des années quarante. Porte des colonnes Il s’agit d’une porte d’accès direct. Elle est dotée de trois arcs au total, celui de l’entrée en brique avec des futs en marbre blanc romains réutilisés au même titre que les chapiteaux corinthiens qui, de toute évidence, n’appartenaient pas à ces futs, un autre arc intérieur outrepassé reposant sur des pilastres et l’arc de sortie d’une grande beauté : sous le linteau de soutènement, cet arc outrepassé orné d’un alfiz alterne les voussoirs en pierre et en brique et forme ainsi une bichromie qui imite les arcs califaux, comme ceux de la mosquée de Cordoue, peints en rouge et blanc. La maçonnerie des murs donne une grande plasticité à l’ensemble. La tour du Christ C’est la porte qui donne accès à l’enceinte inférieure. Elle abrite la seconde porte en chicane, une construction taïfa restaurée à l’époque nasride. L’arc outrepassé visigothique de l’entrée orné d’un alfiz est en brique et sa clé est une voute en pierre sur laquelle est sculptée une clé, comme sur la Puerta de la Justicia (la porte de la Justice) de l’Alhambra de Grenade, où l’on peut observer également une main gravée sur un autre arc. On ne connait pas avec certitude le sens de ce symbole utilisé principalement par les nasrides sur les deux monuments et qui pourrait représenter le pouvoir d’ouvrir et de fermer les portes du ciel accordé à Mahomet selon le Coran. Quoi qu’il en soit, c’est un vieux symbole importé dans la péninsule étant donné que la bannière de Tariq avait une clé. C’est Washington Irving qui l’a rendu célèbre dans ses Contes de l’Alhambra, dont l’un raconte l’histoire de l’effondrement et la disparition de l’Alhambra le jour où la main atteint la clé. On ignore s’il y a eu une main à un moment donné, identifiée comme la Main de Fatima, dont les cinq doigts symbolisent les préceptes de l’Islam (la profession de foi, la prière, le jeûne, l’aumône et le voyage à la Mecque), également gravée à un endroit de l’alcazaba. Au-dessus de l’arc, on peut encore observer deux assises en pierre, restes d’un mâchicoulis défensif, qui sert aujourd’hui de support d’un blason des armes nobiliaires fragmenté installé au moment de la restauration des années quarante. Dans ce cas également, la porte est surmontée d’une voute sur pendentifs formée par une succession d’arcs. Celui de l’entrée, que nous avons déjà mentionné, suivi d’un petit espace recouvert d’une voute en berceau pour compenser le dénivelé, puis un arc intérieur, structurel, qui soutient la voute qui couvre le passage et la sortie, tous deux outrepassés, suivi d’un autre espace vouté et de l’arc final à la sortie de la tour. La voute centrale en brique, sur pendentifs, conserve des restes de décoration peinte en ocre : on peut observer au centre un travail géométrique d’entrelacs entourés de pierre de taille. Lors des travaux de restauration des années quarante, le travail d’entrelacs du mur blanc du sud a été dessiné, peut-être dans le but de le restaurer, mais cela n’a jamais été fait. Sur le mur gauche, avant de sortir de la tour, on peut observer l’intérieur de celle-ci, en moellons en panneresse, datant de l’époque taïfa et l’on voit très bien, comme à d’autres endroits, la maladie de la pierre qui a frappé ce matériau depuis très longtemps, un grès du fond marin avec de nombreux fossiles qui s’obscurcit et finit par se détacher, et qui devient très vulnérable avec le temps à cause de la décomposition intérieure. Tout cela est sans aucun doute la raison de l’utilisation du nouveau matériau, la maçonnerie, qui a été utilisée pour recouvrir tout l’ouvrage taïfa à l’époque nasride. Le nom de « Puerta del Cristo » (porte du Christ) vient d’un retable avec un Christ qui se trouvait à l’intérieur, sur le créneau encore visible aujourd’hui, espace qui a été reconverti en une espèce de chapelle à partir du XVIIe siècle. Jusqu’au début du XXe siècle, ce Christ avait trois œufs d’autruche, sans doute provenant d’une offrande d’un voyageur partant pour des terres exotiques. Ces œufs symbolisent depuis bien longtemps la renaissance de la vie, étant donné que le poussin d’autruche nait de l’œuf uniquement grâce à la chaleur du soleil, sans être couvé par sa mère. Après la restauration, le retable a été retiré dans les années soixante, laissant l’espace vide. La tour avait été transformée en logement et la partie supérieure dut être démolie. La partie construite à partir de la fenêtre est donc récente. |
||
Enceinte supérieure Donjon Situé dans l’angle supérieur de l’enceinte, elle se dresse comme une ruine imposante. Datant de l’époque taïfa, elle a été construite au départ avec un grand arc en briques sur la façade est, qui offrait sans doute un accès indépendant de celui de la Médina à l’intérieur de la première alcazaba, antérieure à la réforme de Badis en 1057. Elle avait une base revêtue de pisé pour en augmenter l’épaisseur, occupant même, à l’époque nasride, une partie d’un des logements du XIe siècle du quartier résidentiel de la zone intérieure. La partie basse conserve les restes des ouvrages de toutes les époques et l’on peut y observer des pierres de taille, des parties en briques et l’on voit très bien le pisé sur la façade sud. Au début de la restauration du monument, il avait été prévu de mettre en œuvre un projet de récupération complète de la Torre del Homenaje, qui prévoyait de construire trois étages et de faire un toit plat qui servirait de mirador sur la ville. Toutefois, face à la grande complexité des ruines et en raison des faibles ressources documentaires permettant de connaitre l’aspect d’origine, les architectes décidèrent de respecter les ruines et de se limiter à les consolider pour conserver cette apparence tellement romantique et évocatrice qu’elle a aujourd’hui, avec sa fenêtre authentique ouverte sur le ciel. Tour du Tir Elle n’a pas non été reconstruite et c’est aujourd’hui un grand cube massif, principalement en pisé. Un pan de muraille partait de cette tour et descendait jusqu’au rempart qui entourait la ville. Il en reste une tour située presque au niveau supérieur du théâtre romain, une autre tour découverte il y a seulement quelques années et qui confirme le tracé qui apparaissait sur les plans historiques Plaza de Armas Située sur une esplanade aujourd’hui entièrement aménagée en un magnifique jardin hispano-arabe, connue sous le nom de Plaza de Armas ou Plaza de San Gabriel à l’époque chrétienne. La conception du jardin est de l’architecte Fernando Guerrero-Strachan Rosado. L’architecte s’est basé sur les gravures de Malaga au XVIe siècle pour installer dans cet espace une pergola qui s’y trouvait selon lui. Quand la place a été restaurée, on a découvert des restes de deux sépultures chrétiennes qui appartenaient sans doute à la paroisse de San Luis, l’ancienne mosquée de l’alcazaba consacrée à San Luis, évêque de Tolosa, le saint du jour où les Rois Catholiques sont entrés dans la ville, le 19 aout. La façade sud de cette esplanade a été renforcée à l’époque pour pouvoir y installer une batterie de canons de faible calibre, étant donné que la construction musulmane ne supportait pas les vibrations produites lors des tirs. La vue depuis ce rempart offre une perspective différente des fortifications de l’entrée, de la ligne qui devait correspondre à la mer et l’on voit très bien l’appareillage du coin de la tour du Christ, renforcée avec des petits moellons en panneresse irréguliers. Quant à la place, le plus significatif est la richesse ornementale des matériaux simples tels que la pierre et la brique combinés à une conception géométrique, la partie centrale en contrebas avec un jardin aux plantations rectangulaires sillonnées de petits canaux qui guident l’eau venant des zones du palais en amont jusqu’à la fontaine centrale du jardin, entourée de quatre massifs de haies basses. La Plaza de Armas est toujours un endroit surprenant pour les visiteurs étant donné que c’est le premier contact avec un espace vert offrant de magnifiques vues panoramiques sur le port de la ville, et non pas seulement de type défensif comme le reste de la visite jusqu’à cet endroit. Il ne reste rien laissant deviner comment l’espace était aménagé à l’époque arabe. La fontaine centrale datant du XIXe siècle provient des jardins de l’établissement d’enseignement secondaire de la rue Gaona où elle avait été installée par les Français pendant la guerre d’indépendance, dans l’ancien couvent des Frères Philippiens, étant donné que les Français l’utilisèrent comme bâtiment officiel pendant l’occupation de Malaga. En raison de la modernisation de l’école et du besoin d’espace pour le sport, les jardins furent aménagés pour pouvoir être utilisés par les élèves. Comme les trois autres fontaines, c’est à cette époque qu’elle a été installée à cet endroit qui était en cours de restauration. Porte des quartiers de Grenade Également connue sous le nom de Puerta del Tinel (porte du Tinel) ou Puerta de Los Arcos (porte des Arcs), depuis les temps anciens. Cette grande tour a été démolie presque entièrement en 1854 au moment où la partie haute tombait en ruine, ne restant que les grands blocs qui formaient les parties inférieures et les lignes d’imposte des arcs, mais elle a pu être reconstruite d’après une gravure de 1839 publiée par Francisco Guillén Robles dans sa publication Malaga musulmana. C’est une porte double d’accès direct, c’est-à-dire qu’il y a un premier passage suivi d’un petit patio fermé et du second passage avec un mur qui bouche le passage et qui oblige à changer de direction, le tout à ciel ouvert. Ce système défensif est très efficace étant donné qu’il permet aux défenseurs, au cas où les attaquants aient franchi le premier passage, de défendre l’accès en jetant différents matériaux du haut, ce qui fait que le petit patio devient une véritable souricière. À cet endroit, on peut observer à nouveau comment les murs latéraux du petit patio sont construits directement sur la roche de la colline, et à la sortie, sur les murs de gauche, on peut voir l’intérieur du mur en pierres de taille en panneresse, caractéristique des constructions taïfa, en roche sédimentaire très abimée à cet endroit. La restauration de la tour, terminée en 1938, est l’œuvre de l’architecte Fernando Guerrero-Strachan. Des espaces intérieurs ont été créés et ont en principe été utilisés comme salles d’exposition pour les objets en céramique restaurés. Cette tour imposante, point dominant et parfaitement adaptée à la forme allongée de la colline, protège l’extrémité ouest de l’enceinte supérieure. Le palais Taïfa Le palais, ou plus exactement, les deux palais dont il reste encore des vestiges, comprend deux bâtiments parfaitement différenciés. On découvre tout d’abord un lieu appelé le Patio des los Surtidores (patio des jets d’eau) qui était le patio central du palais taïfa formé par deux pavillons situés au nord et au sud de ce patio. Aujourd’hui, il ne reste que le pavillon sud. Avec le quartier, il s’agit de l’endroit le plus intéressant de l’alcazaba et le plus riche en ce qui concerne les vestiges découverts. En 1933, toute cette zone était occupée par de petites maisons et l’une d’elles conservait une toiture avec une structure mudéjare. L’exploration a commencé dans cette maison et dans les deux maisons mitoyennes en grattant les murs recouverts de plâtre pour découvrir leur composition. À la surprise de tous, ces recherches ont mis à jour une triple arcature avec corniche arabe dans l’un des murs. Les photos de cette découverte sont impressionnantes. Il ne faut pas oublier qu’il vaut toujours mieux adapter un bâtiment aux nouveaux besoins plutôt que de tout détruire et reconstruire, surtout dans un endroit aussi difficile d’accès comme l’enceinte la plus élevée de la citadelle. Cette partie est celle qui a été conservée au début et a servi de résidence du préfet. Lorsque celui-ci déménagea sa résidence aux quartiers bas, cet endroit fut occupé par des logements du peuple. Le portique sud du palais taïfa possède une salle à laquelle on accède par le chemin de ronde situé à côté de la tour Maldonado en passant sous un grand arc qui avait une porte auparavant. On peut observer encore aujourd’hui, en bas comme en haut, les grands gonds en pierre qui supportaient les battants de la porte ainsi que les niches ouvertes dans les murs de l’accès à une salle surmontée d’une triple arcade outrepassée avec corniche arabe qui rappelle les modèles califaux du salon Rico de la ville-palais de Madinat al-Zahra, avec les entrelacs de voussoirs classiques en rouge et blanc taillés en arabesques, comme l’intrados des arcs. Les colonnes cylindriques, fines et sans base, sont en bois recouvert de plâtre et possèdent un chapiteau typique de Grenade surmonté d’une cimaise en pierre rougeâtre. Le patio de los Surtidores donne sur un portique nasride qui précède l’accès à l’intérieur de la salle composée de trois arches, celui du centre étant le plus grand. Le portique a été rénové aux XIIIe et XIVe siècles, mais il existait déjà au XIe siècle au vu des colonnes en pierre portées par des bases de colonnes de l’époque califale, qui suggèrent que ce n’est qu’une reconstruction. Le portique est formé par trois arcs festonnés appuyés sur deux colonnes en pierre, l’une d’elles d’origine comme le chapiteau qui la surmonte, quadrangulaire et taillé avec des motifs végétaux de manière très stricte quant à la composition, très semblable à d’autres contemporains de l’Alhambra. Sur les cimaises, on distingue encore des écrits en blanc sur rouge en lettres de l’époque nasride qui correspondent à un verset du Coran qui dit « Il n’y a pas de vainqueur, sinon Dieu ». Au départ, pour donner une sensation de symétrie, ce pavillon sud avait été recréé en regard, avec un volume semblable, à base de plantation de cyprès recréant l’architecture. Le palais taïfa possède un autre élément très intéressant : le Pabellón de Arcos Lobulados (le pavillon des arcs lobés) qui se trouve à droite. Ce petit pavillon est également original. Le seul doute concernant sa structure porte sur l’enceinte qui devait exister jusqu’au chemin de ronde, étant donné qu’à l’époque il ne pouvait être ouvert à cet endroit vu que tout le palais était un endroit fermé. Ce pavillon est décoratif, c’est-à-dire que les arcs ne sont pas structurels et on pense que son but était de renforcer la représentation politique de cette partie du palais et qu’il a peut-être servi aux tâches du gouvernement, et imite encore une fois l’art califal somptueux, mais avec des matériaux beaucoup moins luxueux typiques de la période taïfa. Certains auteurs l’attribuent à la période des Hammudites et d’autres à la période Ziri. Quoi qu’il en soit, ils datent du XIe siècle (entre 1026 et 1057) et la décoration répond au même objectif dans les deux dynasties : légitimer le pouvoir en imitant le pouvoir du califat de Cordoue. Après avoir traversé les salles ou être entré par l’accès d’origine du chemin de ronde, on arrive à un patio-terrasse ouvert sur la ville avec la Torre de Maldonado (tour Maldonado) à droite. Cette tour imposante fait partie des éléments défensifs et a été remodelée à l’époque almohade, à laquelle elle a été dotée de magnifiques colonnes en marbre ornées de versets du Coran, sur l’une d’elles « Dieu ! Il n’y a point de divinité que Lui, le Vivant, Al-Qayoum ! » et sur l’autre « Seul Allah est digne d’adoration. En Lui je place ma confiance et c’est à Lui que je retourne », et de la triple arcade par laquelle on accède, qui lui donne un certain caractère représentatif. La salle, qui a également dû être libérée des logements modernes, offrait au moment des démolitions le même aspect qu’aujourd’hui, après que certaines baies situées sur les murs extérieurs et qui servaient de fenêtres ont été fermées. L’arcade et les colonnes sont intactes sous les enduits modernes et on peut également observer, in situ, une arabesque décorative très schématique et sous celle-ci une bande épigraphique avec le texte « La gloire de Dieu est perpétuelle. La gloire de Dieu est éternelle » sous l’arcade, sur la face intérieure. Depuis la fenêtre ouest de la tour ou depuis le chemin de ronde lui-même, il est intéressant de jeter un œil à une tour massive que l’on aperçoit et où l’on voit très bien la base et l’intérieur en pierres de taille de l’époque taïfa, ainsi que le revêtement postérieur en maçonnerie datant de l’époque nasride, et la construction réalisée directement sur la roche, comme nous l’avons déjà vu à plusieurs endroits de la visite. Par le même couloir, qui fait office de portique de la façade sud de la salle du palais taïfa, on accède, à travers un magnifique arc outrepassé très fermé en voussoirs en pierre, à une autre salle spectaculaire de ce bâtiment : la Sala del siglo XVI (la salle du XVIe siècle) ou de la Armadura Mudéjar (de l’armure mudéjare) qui n’a pas été déplacée depuis son origine. Cette pièce a été remodelée par les bâtisseurs mudéjares et l’on estime que les fenêtres ont également été ouvertes à cette époque. Le palais nasride L’entrée du palais de l’époque nasride, distribuée autour de deux patios, se trouve au centre du patio de los Surtidores. L’accès actuel est le résultat de la restauration, car l’entrée originale devait être en chicane. Mais comme celle-ci n’a pas été trouvée lors des fouilles, un accès a été aménagé pour faciliter la visite du public. La zone du palais nasride ne semblait avoir que très peu de choses à exploiter, il ne restait que le rez-de-chaussée du palais, avec les espaces des portes et les bassins, mais la hauteur des restes atteignait à peine 50 centimètres. À l’époque, cette question a été le sujet de nombreuses discussions et spéculations entre les architectes restaurateurs et les autorités pour savoir s’il fallait reconstruire tout l’espace selon une perspective historiciste, pour faire de l’ensemble un musée, ou bien s’il était préférable de consolider les ruines et de les aménager en jardins. C’est finalement la première option qui l’a remporté en se basant sur les reconstructions des palais de Grenade, avec des toitures et des couvertures réutilisées dans certains cas provenant d’autres endroits du monument et en recréant les éléments décoratifs à partir des fragments qui apparaissaient, mais sans rigueur quant à l’emplacement. Tout cet espace apparaissait sur les plans historiques connus comme un verger et a ensuite été occupé par des rues et des maisons, et il ne restait aucune structure émergente. La distribution était claire : deux patios avec des pavillons en regard aux extrémités les plus courtes, nord-sud, avec des porches à trois arcs, mais on n’a pas réussi à savoir s’ils reposaient sur des colonnes ou sur des piliers, quelle était exactement la distribution des alcôves, la hauteur totale des salles et le type de toiture de ces bâtiments. Des portes et des taqas du même type que ceux du palais taïfa furent aménagés. Le Patio de los Naranjos (patio des orangers) s’articule autour des deux petits bassins dont on a retrouvé des traces, et les pavillons, couverts par des voutes d’arête, ont été peints par Hermenegildo Lanz, et les colonnes recréent celles des palais nasrides de Grenade. Le deuxième patio, le patio de la Alberca ou de l’Arrayán, est distribué autour d’un grand bassin central dont les eaux font l’effet d’un miroir de l’architecture, bordé des deux côtés les plus longs par une haie de myrte. Une tour de guet se dressait à l’extrémité nord du pavillon selon les restes et le début d’escalier qui ont été découverts. La salle du portique sud est couverte par un toit en bois qui a été apporté du monument lui-même, concrètement de l’une des salles des pavillons militaires démolis dans la zone du tunnel. La façade nord de ce palais, où se trouvent actuellement des salles d’exposition, et tout particulièrement la dernière de ces salles, présente un grand intérêt quant aux murs originels adjacents au quartier résidentiel et qui permettent d’établir que cette zone remonte au XIe et au XIIIe siècles. Les sols originels sont également conservés dans la salle nord, tout comme une pièce entièrement pavée de grandes pierres de taille dans le pavillon nord de ce patio. |
| Heures d'ouverture - réservation obligatoire / facultative | Fermeture suppl | ||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| avril-septembre | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 10:30 - 20:00 | ||||||
| Prix - online uniquement | Entrée gratuite | Paiement - Cartes acceptées | ||||
| Adulte | Adulte > 60 - 65 | Etudiant | Enfant | Groupe | ||
| Accès |
| FGC | ||||||||||||||||
| Itinéraire à partir de | Description du trajet |
| Type | Domaine | Longueur | Largeur | Hauteur | Superficie | Périmètre | Profondeur | Volume | Inclinaison |
| canon | Histoire | km |
km | m | km2 | km | moyenne : m maximale : m |
km3 |
| Type | Culte | Diocèse | Style | Année de contruction |
Longueur | Largeur | Hauteur | Superficie | Périmètre | Volume | Inclinaison |
| église cagthédrale |
catholique | roman gothique baroque |
km |
km | m | km2 | km | km3 |
| Situation - Région | Pays | GPS / Lat - Long | Altitude | |
|
00° 00' 00" N - 00° 00' 00" E | m |
| Adresse | ||||
|
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture | Fermeture suppl | |||||||||
| Hours: Mardi - dimanche 11:00 - 18:00 | Tickets: jusque |
|||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||
| Basse saison | ||||||||||
| Haute saison | ||||||||||
| Prix | Entrée gratuite | Paiement - Cartes acceptées | ||||
| Adulte | Adulte > 60 - 65 | Etudiant | Enfant | Groupe | ||
| Services, facilités | ||||||||||||||
Audioguide |
Langues |
Wifi |
Photo - Vidéo |
Shop |
Consigne |
Vestiaire |
Cafetaria |
ATM |
Visite guidée |
|||||
| A proximité |
|||
| Musées, expositions | Restaurants, Hôtels | Parcs, promenades | Divers |
| Comment y aller ? | |||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
  |
 |
 |
  |
||||
| Avions | Trains | Métros | Trams | Bus | Minibus | Trolley | Transfer | Voiture | Location Voiture |
Taxi Safari | Parking | A pied | Vélo | Téléphérique Funiculaire |
Cheval | Navigation |
| A voir |
|
|
| A faire |
|
|
| Type | Caractéristiques | Evaluation | |||||||
| Histoire |
| Contact - Nom | Téléphone / gsm | web | note | |
| info | ||||
| réservation | ||||
| office |
| Sites web | ||